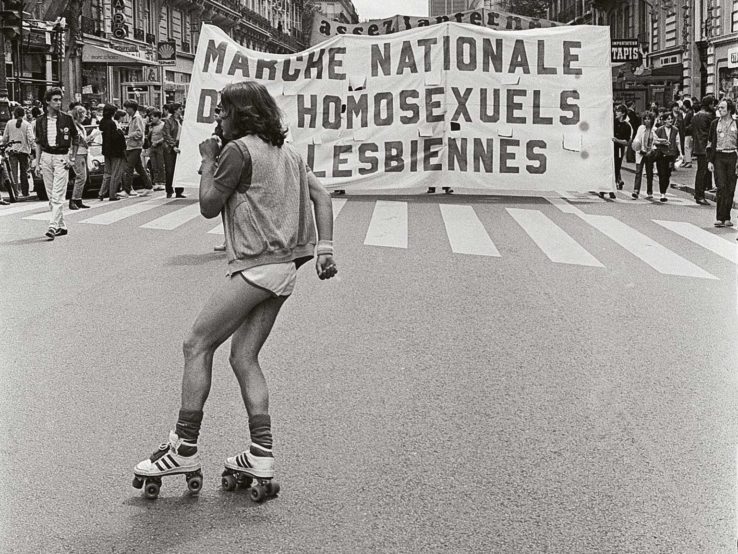Le vendeur de pastèques au bout de ma rue est mort. Pendant des années, je l’ai croisé au coin de la 128e rue, et c’est le temps qui nous dictait la façon qu’on avait de se saluer. Les jours nuageux, il m’avertissait de la pluie. Quand il faisait beau, on se souriait en faisant un signe de tête en direction du soleil. Parfois, il me faisait un clin d’œil avant de dire : “Fais attention à ce que rien ne te tombe dessus”. Ce qu’il voulait me dire, c’était de ne pas me laisser abattre par la lourdeur de la ville. “Jamais”, je lui assurais. Je ne connaissais pas son nom et il ne connaissait pas le mien, mais l’été, je m’arrêtais pour fouiller dans son stock, cherchant les pastèques avec le plus d’égratignures. Il m’avait appris que cela indiquait que les opossums et les écureuils avaient essayé d’entamer leur chair alors qu’elles n’avaient pas encore été cueillies, signe de leur sucrosité. Tous les marchés locaux vendent des pastèques sans pépins, des mutations génétiquement modifiées, mais les siennes, bien mûres, avaient de gros pépins noirs que je crachais sur la grande colline du parc de St. Nicholas avec des amis qui se délectaient de leur jus.
Je ne l’ai jamais vu ailleurs qu’au coin de ma rue. Je le voyais chaque jour en partant au travail et en rentrant chez moi. La laverie est juste en face de son emplacement et, un jour, il a ramassé sur le trottoir des culottes qui étaient tombées de mon sac à linge et me les a rapportées à l’intérieur sans me regarder dans les yeux. Je lui suis reconnaissante de cette courtoisie. Pas nécessairement pour avoir rapporté mes sous-vêtements, mais pour avoir évité de croiser mon regard dans ce moment gênant. C’est la seule fois que je l’ai vu s’éloigner de son poste. Son stand n’était qu’une simple table pliante sur laquelle il disposait des pastèques coupées en tranches afin que leur arôme et la couleur vive de leur chair attirent les passants. Il portait toujours une chemise imprimée et n’avait pas peur du contraste entre les couleurs pastel et sa peau noire. Le camion qui lui servait d’arrière-boutique n’était rempli que de pastèques et couvert de graffitis, dont un tag qui disait : “Cute & Sad”. Autant que je sache, il vivait à ce coin de rue, dans ce camion. C’était sa propre petite enclave, qu’il partageait avec nous, et je peux imaginer que ce spectacle quotidien manque à beaucoup d’habitants de Harlem. Le simple fait d’être vu a un grand pouvoir. Chaque jour, lorsqu’il me reconnaissait, c’était comme s’il me disait : “Je te vois, tu n’es pas invisible”.